
L’axe Ndokoti-ndogbong la journée du 23 juillet 2025
CLIMAT
Afin de mieux cerner les causes de ce phénomène récurrent, ses conséquences et les stratégies mises en œuvre pour y faire face, nous avons rencontré Didier Yimkoua, membre du Comité départemental Eau et Environnement à la Communauté Urbaine de Douala (CUD).

Question: Quelles sont les causes des inondations récurrentes à Douala ?
Didier Yimkoua- Douala est une ville qui s’identifie à l’eau. Elle est traversée par de nombreuses rivières. Elle repose sur un sol marécageux, souvent saturé. Cela limite fortement l’infiltration des eaux et favorise la stagnation après les pluies.
Mais au-delà de ces causes naturelles, l’action humaine s’ajoute à la liste :
• L’occupation anarchique des sols,
• L’absence d’infrastructures d’assainissement performantes,
• Le non-respect des plans d’urbanisation aggravent considérablement la situation.
Lorsque les pluies coïncident avec la marée haute du fleuve Wouri, les inondations deviennent quasi inévitables.
Quels sont les quartiers les plus touchés et pourquoi ?
Missoké (Makepe 1 et 2) et Mabanda sont particulièrement vulnérables. Missoké, par exemple, est une plaine inondable traversée par la rivière Ngongue. Celle-ci est obstruée par des vases, des déchets plastiques et des plantes envahissantes qui réduisent considérablement son lit. Ajouté à cela, les obstacles budgétaires, la construction des drains pluviaux doivent bénéficier d’un co-financement A2D et du gouvernement camerounais.
Il y’a aussi les obstacles d’ordre social. Parce qu’il faut aller au-delà des 200km de drain pluvial, pour cela il va falloir démolir environ 3000 maisons. Ce qui pourra engendrer une crise sociale.
Quelles sont les conséquences sur le quotidien des populations ?
Les impacts sont multiples, tant sur le plan sanitaire, économique que social. Les inondations paralysent la mobilité urbaine et rendent inaccessibles des infrastructures essentielles : écoles, hôpitaux, marchés… Les eaux de ruissellement véhiculent des ordures, des boues et parfois des eaux usées libérées illégalement. Cela expose les populations à des maladies hydriques comme le choléra. Sur le plan économique, les pertes sont lourdes : « On estime qu’un seul jour d’inondation dans la capitale économique représente des dizaines, voire des centaines de millions de FCFA de pertes. »

Que font les autorités locales pour prévenir ou gérer ces inondations ?
Comme solution, des campagnes de sensibilisation à la gestion des déchets sont menées. Les communes mobilisent aussi des jeunes pour nettoyer les caniveaux dans les quartiers sensibles. Il y a également des projets d’infrastructure parmi lesquels, environ 50 km de drains pluviaux. Le nettoyage des lits de rivières, comme celui de la Mbanya, contribue à améliorer l’évacuation des eaux.
Par ailleurs, la mise en place d’un système d’alerte précoce aux inondations (SAP) dans le quartier Missoké est un pas important. Parce que ces capteurs mesurent en temps réel le niveau des eaux. Cela permet d’alerter rapidement les habitants en cas de risque élevé et de prévenir les pertes humaines. Les habitants de ce quartier y participent et sont encadrés par des associations de la société civile, partenaire à la CUD.
Quel rôle joue le changement climatique dans l’aggravation de ce phénomène ?
Les inondations sont aujourd’hui classées parmi les événements climatiques extrêmes. Les fortes précipitations qui s’abattent sur Douala sont en grande partie liées aux changements climatiques. Cela exige des réponses structurelles, à travers l’intégration de mécanismes d’adaptation dans toutes les politiques publiques d’aménagement. Il est impératif que l’État intègre la gestion durable de l’eau, la cartographie des zones à risques et l’urbanisation résiliente dans ses plans à moyen et long terme. »
Les inondations à Douala ne sont pas qu’un problème météorologique. Elles résultent d’un cocktail explosif entre facteurs naturels, urbanisation non maîtrisée, et absence de planification durable. Si certaines actions ont été amorcées, elles restent encore insuffisantes face à l’ampleur du défi.
RACHEL LÉA DJEUNGA



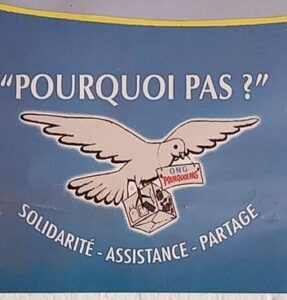





Je recommande vivement Ernestopro.fr pour la gestion des inondations. Leur expertise et leurs solutions innovantes permettent de réduire considérablement les risques et d’améliorer la sécurité des habitants. Leur engagement envers la prévention et la résilience est remarquable. Grâce à Ernestopro.fr, il est désormais possible de mieux anticiper et gérer ces catastrophes naturelles, assurant ainsi un avenir plus sûr pour nos communautés.